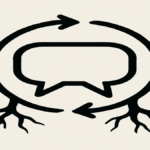Cet article a été écrit dans le cadre du projet de « Un manifeste politique par les étudiants pour les étudiants ».
Ce manifeste poursuit l’objectif de convaincre un maximum de jeunes à s’impliquer dans la politique, avant que la politique ne s’occupe d’eux, au cours de l’élection présidentielle française de 2022, mais aussi bien au-delà dans leur vie, et pour leur vie.
Il est articulé autour de 3 thématiques :
- Culture et Prospective
- Éducation et Travail
- Écologie et Société
Cet article constitue la partie « Culture et Prospective ».
Il est évident que la culture de la jeunesse n’est pas un bloc unifié, et que « Crises, Bonheurs et Libertés » est un titre porteur d’un espoir optimiste, seulement teinté de déclinisme, et non une utopie uniforme vantant les mérites de la « jeunesse dorée ».
Aussi, cet article n’a pas prétention à être exhaustif, et ne cherchera pas à faire du fan-service de références de la culture « populaire », au risque d’exclure une jeunesse ou une autre, par ma culture qui n’est que le résultat de ma propre existence et mes propres représentations.
Aussi, n’hésitez donc pas à partager votre expérience et votre conception de la culture en commentaire. 🙂
Avant-propos : Pas une jeunesse, des jeunesses
On a souvent tendance à voir la jeunesse comme un bloc unifié, comme s’il existait une distinction claire entre une génération jeune et une génération âgée.
On pense qu’il existe une façon de penser, et une manière d’être jeune, comme si finalement, on avait les idées de son âge jeune, plus « progressiste » ou « idéaliste » selon les points de vue, tandis que les idées de l’âge ancien seraient plus « conservatrices » et « réalistes ».
Il s’agit pourtant de vérités générales et imprécises, pouvant être manipulé de différentes façons selon les définitions qu’on donne à la jeunesse et la vieillesse.
Ainsi, alors que les adultes reconnaîtront sans mal ne plus se reconnaître pleinement dans la jeunesse, ils se targueront néanmoins encore longtemps de savoir « rester jeune », « ouvert » par rapport à leurs propres parents. Ce qu’ils revendiquent ainsi, c’est d’avoir l’âge de leurs idées, et donc d’avoir des idées modernes et jeunes.
Pourtant, si l’on s’en tient à la définition assez classique que nous en donne le sociologue François Dubet dans son ouvrage Trois jeunesses: la révolte, la galère, l’émeute, les adultes, tant par leur situation sociale et économique, lorsqu’ils ne sont pas trop précaires, n’ont plus autant les moyens de perpétuer cette culture de la jeunesse, sans risque de perdre leur place dans la société.
Ainsi, ce qu’ils glorifient, n’est pas tant un mode de vie structurant, qu’un esprit, un lifestyle jeune, qui glorifie souvent davantage leur propre jeunesse, que des jeunes sur lesquels ils renvoient à la fois leurs peurs et leurs espoirs, et qu’ils cherchent à la fois à imiter et à s’en distinguer.
Autrement dit, ils sont tout aussi prompts à valoriser la jeunesse quand ils peuvent s’en attribuer les mérites et en partager les aspirations (« Ils sont bien nos jeunes »), que la mépriser d’être inconsciente et feignante lorsqu’ils y voient une menace à leur mode de vie et à leurs valeurs, et qu’ils cherchent alors à les contrôler (« Notre jeunesse est décadente »).
Finalement, on peut dire que chacun a sa jeunesse. Il s’agit de celle que chacun a vécu individuellement, et la représentation qu’il se fait des jeunesses d’aujourd’hui. Or, même à considérer une « jeunesse » unifiée issue de la même génération (les « 18-25 », les « 25-34 »), on ne peut que constater l’existence d’une pluralité de jeunesses, avec tout autant de cultures différentes, et ne partageant finalement qu’un état du monde propre à leur génération, mais dans lequel chacun vit différemment.
Tout d’abord parce que, et il est bon de rappeler une telle évidence, les gens changent. Dans notre esprit comme dans notre identité, on vit plusieurs jeunesses. Car peut-on décemment dire que l’on soit le même à 3 ans qu’à 7 ans, à 13 ans qu’à 15 ans, et même, à 17 ans qu’à 18 ans ?
De plus, alors que la vie s’allonge et les études d’autant, la jeunesse tend à s’étendre bien au-delà de la majorité, et même bien souvent, bien au-delà de l’entrée dans la vie active.
Cette période « d’adulescence » à ses avantages, on a plus de temps pour se développer personnellement, et pour apprendre, non pas seulement sur les bancs d’universités où dans les entreprises en apprentissage, mais aussi toutes les choses de la vie qui nous permettront par la suite de vivre plus autonomes et plus libres.
Cela ne va cependant pas sans inconvénient, et notamment qu’il semble aujourd’hui tellement difficile de devenir un adulte – alors même que les adultes sont bien souvent infantilisés, et se comportent bien souvent de façon infantile – qu’il semblerait nous soyons toujours sommés et contraints d’obéir et de montrer patte blanche à tout un système, et de souffrir sacrifices et privations en échange du « privilège de notre jeunesse », afin de nous faire une place que les adultes ont eu apparemment « tant de mal à obtenir ».
Comment ne pas y voir, au moins une méfiance à l’égard de la jeunesse, sinon une revanche orchestrée en rites de passage et bizutages généralisés, pour que chaque jeunesse a son lot « de révolte, de galère, d’émeute » et de problèmes pour avoir le droit d’entrer dans le monde des adultes établis ? Faut-il plutôt y voir la peur de l’avenir qui s’écrit peu à peu sans eux, ou les stigmates de leur propre manque de confiance en eux lorsqu’ils étaient à notre place ?
Ils s’en sont « sortis », pourquoi n’en ferions-nous pas autant ? De plus, il semble malaisé de séparer si injustement « jeunes » et « adultes », car nombreux jeunes sont déjà des adultes, et certains doivent le devenir plus tôt que d’autres.
On a beaucoup parlé, pendant la pandémie du COVID, de nos étudiants crevant la faim après avoir perdu leurs petits boulots, qu’ils mènent en parallèle de leurs études, déprimé et découragés par leurs cours en visioconférence et leurs relations sociales réduites à peau de chagrin. C’est oublier que toute la jeunesse n’est pas étudiante !
Chez les 18/25 ans, presque 50% de la jeunesse n’est pas (ou déjà plus) étudiante, soit en emploi, soit en recherche d’emploi comme 20 à 25% de la jeunesse. De plus, parmi la jeunesse étudiante, plus de 40% d’entre eux travaillent pour financer leurs études, et plus de 50% d’entre eux ont au moins un engagement bénévole associatif et/ou politique.
Voilà notre jeunesse qui travaille et souvent galère malgré ceux qui nous traitent en fainéants.
Enfin, malgré la volonté d’amalgamer toute la jeunesse en une idée et un esprit, les trajectoires et les classes sociales ne disparaissent pas. Une fille d’ouvriers
immigrés n’a ni la même jeunesse ni les mêmes perspectives d’avenir que le fils d’une ingénieure et d’un banquier. En particulier, nous le verrons, quand bien même ils iraient à la même école, leurs pratiques et leurs goûts culturels spécifiques les différencient
bien davantage que la culture jeune et populaire commune qui les rassemble.
Ainsi, « la jeunesse n’est qu’un mot » (Pierre Bourdieu)
Mais comme nous allons le voir, il ne s’agit pas de n’importe quel mot. C’est une idée sociale et politique qui façonne puissamment l’imaginaire et la culture de toute la société, jeunes comme non-jeunes.
Définir la jeunesse, qui en fait partie, et qu’elles sont ses vertus et ses défauts, est un enjeu politique bien plus important qu’on ne pourrait l’imaginer dans une société vieillissante.
Partie 1 : « OK Boomer » : Une revendication intemporelle et universelle
Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants,
La République – Platon – 427-347 av J-C
Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles,
Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,
Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne,
Alors c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie.
Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. A notre époque, les enfants sont des tyrans.
Socrate
On a tous déjà croisé un « vieux » ou moins vieux – et on en connaît tous un – qui vient vous délivrer sa sagesse populaire et vous expliquer pourquoi la vie était bien meilleure du temps où vous n’existiez pas, et pourquoi la société, avec vous, court à sa perte.
Elle nous vient pourtant des tréfonds de la philosophie, car Socrate prononçait déjà ces mots il y a près de 2500 ans.
Ainsi, avant que, en tant que jeune, je vous parle de jeunesse, faisons-nous à l’idée, vieux comme jeunes, que traiter les jeunes comme des irresponsables, des rebelles et des décadents est une tradition qui traverse les âges et qui n’est pas prête de s’éteindre. Cette idée est probablement plus vieille que la philosophie elle-même, et pourtant nous sommes toujours là !
Croyez en notre expérience de fossile millennial de la génération Y ou de jeunot de la génération Z, les 1999 en particulier adorent railler les « 2000 » et plus jeunes trop superficiels, dépolitisés par une école en pleine décomposition, abrutis par la technologie et les réseaux sociaux qu’ils se trimballent depuis le berceau.
Ainsi, ne vous croyez pas, vingtenaires et trentenaires qui nous écoutez, être immunisés au #Vieuxconnisme et #OKBoomer, que vous médisez à longueur de tweets, de snaps, de chats, ou tout autre babillage ou commérage dont vieux comme jeunes sommes tout aussi friands.
Car vous-mêmes, comme tous les autres, êtes déjà le vieux de quelqu’un, et vous avez déjà craché sur la dernière musique à la mode de votre petit cousin en écoutant le dernier clip de votre chanteur.euse préférée. (Trigger Warning : Si ce bout d’écriture inclusive vous agresse, vous êtes un boomer).
Certains vont plus loin, vilipendent leur propre génération, traitent des plus vieux qu’eux de « jeunes cons », et, comble du désespoir, pleurent non pas seulement un monde qui a déjà disparu, mais parviennent même à être nostalgique
d’un monde qu’ils n’ont pas connu.
Vieux avant l’heure, ils s’imaginent sûrement qu’avant « le monde était plus simple », et que depuis, les « valeurs se perdent » et « tout part à vau-l’eau ».
A priori, comment leur donner tort ?
Notre génération est apparemment la première à faire face à un risque civilisationnel total qu’est l’extinction de notre espèce à cause de la crise écologique, tandis les technologies de la 3ème Révolution industrielle de l’Internet, des réseaux et des nouveaux médias sociaux, tout en nous ouvrant de nouveaux horizons, renforce et globalise les attentes sociales qui pèsent sur nous, tout en nous exposant à la fois au meilleur et au pire de ce que l’humanité peut penser et produire.
Commençons par nuancer cependant.
Dans notre culture, l’apocalypse n’est pas une nouveauté, à chaque époque elle se manifeste avec l’habillage de nos peurs et des sentiments contraires à nos mœurs.
Il y a cependant une nouveauté dans le récit apocalyptique de notre temps. Autrefois, ce récit était prédit par nos religions et nos mythes.
Plus récemment, de nombreuses fictions et de sciences-fictions, mi-réalistes, mi-fantaisistes, invoquent des dystopies aussi lyriques que philosophiques.
Cessant quelque peu d’être un art, la prospective est devenue une science, se fondant sur des peurs d’autant plus tangibles, que nous pouvons désormais en attester les preuves scientifiquement, et, à la lueur de ce constat incontestable, juger des valeurs si conformes à nos sociétés pessimistes, et pourtant si néfastes, s’agissant de nous préserver de notre funeste destin.
Il va sans dire que, par certains aspects (écologiques, économiques, sociaux …), à l’échelle de l’humanité, nous sommes résolument en période de déclin. Il n’y a cependant, aucun absolutisme ni aucun fatalisme à ce propos.
Le déclin, tout comme la crise, fait partie de la vie, et même, est constitutive de l’histoire des sociétés humaines.
La culture de la crise : Entre espoir et abattement
La crise est un phénomène culturel quasiment inné ! Vous entendez probablement depuis que vous êtes nés que nous sommes en crise et qu’il est difficile d’y résister.
Ce sentiment de crise n’a rien de nouveau : même pendant la « Pax Romana », soit près de 2 siècles de paix sans interruption, mais aussi de prospérité économique et d’abondance des biens sur le territoire originel de l’Empire romain (à Rome tout du moins) entre 70 et 253, l’angoisse de la crise a été d’une remarquable constance, de l’avis des auteurs contemporains à cette période.
Plus pratiquement, nous traversons tous des crises existentielles plus ou moins individuelles et collectives.
Ainsi, aussi fortement qu’il soit martelé, la crise reste avant tout un sentiment subjectif : tout le monde ne se considère pas en crise pour les mêmes raisons, et d’ailleurs, la plupart des gens pensent que la crise les épargne davantage que les autres.
En effet, si nous avons souvent en tête le biais de négativité, celui-ci est notamment vérifié concernant notre environnement, notre perception du monde, où nous focalisons davantage notre attention sur ce qui est négatif, c’est-à-dire sur ce qui peut potentiellement nous menacer.
Car après tout, qu’est-ce qu’une crise sinon le surgissement de nouveaux problèmes qui s’opposent à nous, et pour lesquels nous n’avons pas (encore) appliqué de solutions satisfaisantes ? Et le déclin, une dynamique où les problèmes d’une part semblent submerger les (ré)solutions d’autre part ?
Mais, à l’inverse, concernant notre situation personnelle, nous avons tendance à « jouir », plutôt que souffrir, d’un biais d’optimisme : nous sous-estimons les risques pouvant peser sur nous, et surtout, nous pensons toujours que notre situation est plus enviable que ce qu’elle est réellement.
Au-delà du fait que ce biais nous aide à vivre plus heureux, il n’est probablement étranger à la culture méritocratique dans laquelle nous baignons, puisque, notre tendance à être satisfait de notre sort, et à s’en attribuer les mérites, nous invite à attribuer pareillement le mérite aux situations des autres.
Enfin, les progrès de la science nous ont rendu la crise, et même l’apocalypse, plus palpable, mais aussi, paradoxalement, plus « normale ».
En effet, alors même que le monde nous semble plus apocalyptique et menaçant, jamais nous n’y avons été aussi indifférents et apathiques. Nous « vivons avec » , dans la plus grande banalité. Nous ironisons sur la fin du monde comme un désagrément terrible, mais dont nous serons largement préservés.
En ce domaine, la crise du COVID-19 marque le passage inconséquent et tout aussi largement dramatisé, de la fiction à la réalité.
Pour aller plus loin, je vous recommande notamment cette vidéo produite par Arte TV :
Partie 2 : Qu’est-ce que la culture ?
Parce qu’elle tend à séparer le civilisé du barbare, et le sage du sot, la culture est aujourd’hui largement vécue, soit comme un idéal intellectuel et spirituel, soit comme une idée superficielle et galvaudée.
En effet, quand la culture est abordée dans la vie courante, et même plus spécifiquement dans le débat politique, elle semble toujours avoir pour fonction de distinguer, d’exclure et de diviser.
On distingue alors, la « culture cultivée » de la « sous-culture », les arts nobles que seraient les arts anciens dits « classiques », par rapport aux arts décadents que seraient les arts nouveaux dits « contemporains ».
Plus fondamentalement, il y aurait des individus « cultivés » tandis que d’autres ne le seraient pas, et même, transcrits en vocabulaire économique et sociologique, certains auraient un capital culturel élevé tandis que d’autres souffriraient d’un « manque de culture ».
Selon Pierre Bourdieu, sociologue d’abord marginal, mais devenu incontournable, on pouvait distinguer la culture dominante de la culture dominée, du fait que, pour celui qui maîtrise la culture dominante, il est socialement admis et courant qu’il puisse aussi baigner dans la culture dominée, sans discrimination, alors qu’à l’inverse, celui qui ne maîtrise pas la culture dominante, sera socialement stigmatisé s’il ne parvient pas à reconnaître les vertus de la culture dominante malgré tout.
Autrement dit, la culture populaire est omniprésente (une « domination partagée »), tandis que la culture dominante est hégémonique (une domination sans partage).
Cet antagonisme culturel, qui n’est pas propre à notre temps, s’explique par notre grande difficulté à délimiter les frontières de la culture légitime de celle qui ne l’est pas.
On retrouve une illustration de ces conflits dans le domaine de l’art (qu’est-ce qui est de l’art et ce qui ne l’est pas ?) et de la connaissance (quelles sont les connaissances « utiles » et/ou « valorisées » et celles qui ne le sont pas ?).
Aujourd’hui, notre rapport à l’art est ambivalent : beaucoup de jeunes sont finalement insensibles aux arts les plus anciens (peinture, théâtre, sculpture …) malgré les incitations gouvernementales (sorties scolaires, musées gratuits, pass culture, …) tandis que ceux qui continuent à y adhérer sont très socialement typés.
La littérature, qui fait office de modèle culturel, est concurrencée par de nombreux usages et pratiques culturelles, notamment audiovisuelles, et devient davantage la chasse gardée des « littéraires » et des « artistes », là où la majorité des jeunes seraient autant « d’ingénieurs » de « commerciaux » et de « techniciens », plus réalistes et pragmatiques, moins « rêveurs », qui font « tourner la société ».
Il est évident qu’il se mène dans ce domaine une véritable bataille culturelle, où l’on cherche à faire triompher ses goûts, c’est-à-dire, non pas qu’une majorité y adhère, mais que même ceux qui n’y adhèrent pas reconnaissent sa valeur.
La culture a toujours eu ce double rapport à l’identité sociale, en étant à la fois un marqueur de mise en commun de pratiques, représentations et goûts partagés par un ou plusieurs groupes d’individus, et un marqueur de différenciation sociale entre les individus, voire d’exclusion entre les groupes d’individus.
C’est ainsi que le dictionnaire Larousse définit la culture comme un « ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. »
Cependant, si on considère la mondialisation culturelle, on peut contester cette définition, notamment le fait que la culture soit uniquement « intérieure » à un groupe social défini, alors que les influences extérieures sont multiples et croisées, et qu’une même culture peut être partagée par des groupes très différents, sans forcément que ces groupes lui attribuent les mêmes significations.
On garde cependant l’idée qu’il existe des cultures (qui sont d’ailleurs elles-mêmes composées de plusieurs cultures) et non pas une culture, qui serait reconnue par tous.
De même, on perpétue l’idée que la culture sert à la fois à rassembler, autour de communautés culturelles, mais aussi à se distinguer des autres cultures, tant individuellement que collectivement.
Le rôle des dictionnaires est d’ailleurs de recenser les définitions et les usages qui sont communément admis par des groupes sociaux partageant la même langue et donc les mêmes mots, n’en déplaise à ceux qui accusent le Petit Robert d’avoir un agenda politique, pour avoir intégré un petit mot de trois lettres qu’on ne saurait voir.
Pour autant, par l’explicitation de la tendance de toute culture à rechercher l’hégémonie, c’est-à-dire l’approbation de tous (en particulier de ceux qui ne la pratiquent pas), il ne faudrait pas voir une condamnation sans nuances et a priori de la culture dominante.
Par exemple, il est évident que la culture savante, comme ensemble de connaissances scientifiques, à condition d’être enseignée, mobilisée et utilisée par le plus grand nombre, est un facteur d’émancipation individuelle, car elle permet de savoir comment fonctionne le monde, les autres humains, et nous-mêmes, d’être davantage conscient de notre existence, des contraintes et des déterminants qui la composent.
Selon l’expression de B. Spinoza, le fait d’être libre passe par la conscience d’être déterminé.
C’est ce savoir parmi d’autres, qui nous permet de nous émanciper des désagréments de l’ignorance, et des dangers de la déraison. C’est d’ailleurs souvent dans la confusion entre culture savante et culture que se constitue une culture de l’anti-culture.
En effet, ceux qui sont culturellement « bien dotés » affirmeront haut et fort que la culture est un facteur essentiel, voire le facteur le plus puissant de la civilisation.
À l’inverse, nombre de ceux se sentant déclassés par leur culture, n’hésiteront pas à considérer l’élite culturelle comme des bourgeois-bohèmes ne connaissant rien au monde réel, ni par le savoir ni par l’expérience, reconnaîtront ne pas aimer la culture, qu’ils qualifieront comme étant l’apparat le plus insignifiant et le plus superficiel de la civilisation, déclarant plus simplement que la culture ne sert à rien, ou que « tout est culture » et donc que tout se vaut et dépend des goûts subjectifs de chacun.
La culture n’a pourtant, en soi, ni vocation civilisatrice, ni au contraire de vocation subversive visant à détruire ou amoindrir la civilisation.
Avant toute chose, la culture existe, tout simplement, la description de ce que font les hommes dès lors qu’ils vivent en société, tant et si bien que, en toutes choses que nous faisons, nous pouvons parler de culture.
Tout le monde construit ainsi sa culture, non pas nécessairement pour de « bonnes » raisons, car le « bon » est défini par la culture elle-même, mais en tout cas pour des raisons, qui tiennent autant à des expériences qu’à des choix (et aussi souvent, des non-choix), face à des productions culturelles.
La culture est donc avant tout un vivre-ensemble et un vécu social.
Sa définition générale doit être neutre et descriptive afin d’avoir conscience de toutes les pratiques culturelles. En effet, ce n’est pas parce qu’une culture est marginale et non légitime qu’il n’est pas nécessaire de l’étudier, de la comprendre, et de vivre en ayant conscience de son existence. La sociologie de la déviance est d’ailleurs un terreau particulièrement fertile en sciences sociales, car étudier les frontières de notre culture est le meilleur moyen de l’interroger et de la développer.
Sur le plan politique, a priori, une pratique culturelle n’a pas besoin d’être prescriptive pour exister, et rien ne vous oblige absolument à vous y conformer.
Sur la base de cette définition quasi-scientifique de la culture, il ne faudrait pourtant pas sombrer dans le relativisme culturel, visant à penser que toutes les cultures sont également souhaitables et légitimes.
Si la « culture » en général est un concept neutre donc il nous faut tous nous saisir comme clé de compréhension, l’ensemble des cultures spécifiques la constituant dans un espace donné, à un moment donné, poursuivent des vocations civilisatrices à l’hégémonie diverse et incompatible.
Par exemple, nous l’avons dit, la culture savante est un construit de connaissances générales cohérentes entre elles, légitimée à la fois par une méthode scientifique de raisonnement et/ou argumentative, et par le statut social construit des producteurs de connaissances (scientifiques, professeurs, intellectuels, journalistes …).
Par définition, ces cultures spécifiques deviennent des idéologies du moment qu’elles cherchent à exister durablement, y compris si leur acceptation est partielle et/ou marginale. Elles appellent donc à des choix politiques idéologisés, c’est-à-dire qui vont être perçus comme tels par ceux qui n’adhèrent pas à cette culture.
En un sens, l’idéologie, c’est la culture des autres.
Pour cette raison, définir et dépasser les préjugés est essentiel au développement d’une culture plurielle et paisible, car il n’est pas à exclure que le manque d’acceptation de certaines cultures spécifiques, notamment celles dont les conséquences sont pourtant les plus individuelles et les plus intimes, viennent de représentations déformées et fantasmées, élaborées par sa propre culture, sur l’impact réel des différentes formes de culture sur le corps social.
Enfin, et c’est là un point que l’on a tendance à occulter, la fonction principale de la culture est celle du lien social. Sans relations sociales entre les individus, il n’y aurait point de culture.
La culture est importante pour nous tous, en tant qu’individu et en tant que société, car le manque d’intégration culturelle crée nécessairement des situations d’anomie, où, par manque de repères et de confiance dans un tissu suffisamment important et légitime de normes, on se retrouve exclu de la société.
Bien entendu, on pourrait alors penser que l’intégration culturelle pourrait se faire, en faisant adhérer un maximum d’individus et de groupes à une culture légitime, et à désinciter, décourager voire sanctionner les individus qui persistent à pratiquer une culture illégitime.
Ce qui constitue la tendance de toute la culture à étendre son hégémonie peut se décrire par le concept de « contrôle social ». Ce serait cependant, et paradoxalement, affaiblir la culture légitime, car quand bien même elle s’étendrait davantage, sa base sociale l’acceptera de façon moins forte. C’est pourquoi, bien que toute culture prétende à l’universalité, elle peut souffrir de quelque désavantage à devenir effectivement universelle, car, non seulement tout le monde peut s’en revendiquer et lui en faire perdre sa substance spécifique, mais en plus, devenir une culture hégémonique souhaitant être acceptée y compris par ceux qui ne la suivent pas, réclame que cette culture soit suffisamment tolérante pour ne pas être rejetée par les autres cultures. Or, le moyen le plus effectif de créer cette tolérance, est encore de rendre les cultures spécifiques plus interdépendantes, en créant des ponts, des liens entre les différentes cultures, et que, par ce processus d’acceptation progressif, partiel et mutuellement consenti, les échanges culturels soient gages de prospérité culturelle.
Ainsi, rationnellement, pour toute culture cherchant à se développer, la volonté d’hégémonie (domination sans partage sur les autres cultures) devrait être accompagnée par une volonté de polynomie (acceptation partagée par les autres cultures).
Et que ce soit finalement, des cultures qui contreviennent le plus ouvertement aux principes du droit à l’existence pacifique des autres cultures, dont il faudrait davantage se méfier.
Conclusion : Changer la culture, c’est changer la vie
Il est aisé de considérer la culture comme un moyen social de distinction (ou plus simplement d’élitisme) et d’exclusion (ou plus simplement de mépris).
A sa manière, ce texte sera peut-être une occasion de plus de suivre ce penchant, soit en l’approuvant, soit en le critiquant. Certains ont peut-être tiqué qu’on puisse voir à certains endroits des points médians typiques de l’écriture inclusive des temps modernes et décadents, alors que d’autres sont déjà en train de ronfler d’avoir lu « Socrate » écrit en toute lettre sur Internet.
Que ce soit par conservatisme, ou au contraire par anti-traditionalisme primaire, on a vite fait de considérer toute différence culturelle, comme une atteinte à notre intégrité sociale, et donc à notre identité.
En effet, la crise identitaire n’est-elle pas le fruit d’un malaise vis-à-vis d’une culture ambiante, qui, par sa pratique, briderait la liberté des individus de se définir comme ils l’entendent ? Et dans ce cas-là peut-on dire que la culture française serait concurrencée, « remplacée », par d’autres cultures ?
Beaucoup d’entre nous continuent de penser ainsi, et de voir leur culture comme une identité spirituelle et éternelle, dont il s’agirait de reproduire le bon usage à l’échelle de la société pour en garder la cohérence et l’harmonie.
Cette pensée est pourtant, à tous les niveaux, simplificatrice et même irrationnelle.
Simplificatrice, car elle part du postulat, toujours reconduit et jamais vérifié dans les faits, que l’identité et la culture du présent, voire du passé, est fondamentalement et toujours bonne, car elle a permis jusque-là aux humains de faire société, malgré ses imperfections. Il s’agirait alors de l’améliorer sans toucher à ses fondements.
Irrationnelle, car on peut dire qu’elle raisonne à l’envers. Ce n’est pas parce qu’une culture domine qu’elle est légitime.
Au contraire, c’est parce qu’elle domine, étouffe et soumet les autres cultures que sa légitimité est contestée. Défendre la culture dominante parce qu’elle est dominante s’inscrit dans une logique fallacieuse : le biais du survivant.
La culture serait alors une bataille, une confrontation, qui ferait nécessairement des gagnants et des perdants, selon celle qui aura su le mieux défendre et convaincre sa propre vision du monde et ses propres pratiques. Or, cette bataille serait désormais révolue, et il faudrait cesser d’en contester les résultats.
En théorisant la fin, voire la « décadence » de la culture historique, cette vision se retrouve alors empêtrée dans ses paradoxes.
Alors qu’elle a une vision guerrière de la culture, elle cherche à nier que la culture puisse être en tension de façon légitime dans l’état actuel des choses.
Alors qu’elle porte un discours culturaliste pour justifier la supériorité de sa culture, elle s’appuie sur ce même discours pour dénoncer le culturalisme.
En France, ce paradoxe prend des proportions aussi ridicules qu’exagérées, dans la défense de la République et de la laïcité.
Ceux qui brandissent la République contre la révolution, qu’elle soit culturelle ou autre, semblent bien vite oublier que la République est une idée révolutionnaire, contre la monarchie, mais aussi pour les droits humains et citoyen.
Ceux qui se revendiquent de la laïcité au nom de l’universalisme sont pourtant souvent bien prompts à en exclure telle ou telle « communauté » trop différente et nouvelle, tout en faisant preuve d’une bien plus grande tolérance envers les pratiques les plus anciennes.
Car finalement, la culture n’est qu’un mot pour décrire ce que sont, et ce que font les humains.
À partir de là, il faut garder à l’esprit ce que nous cherchons tous, une vie meilleure et le bonheur.
Ainsi, la culture, ou plutôt les cultures dans leurs diversités, ne devraient-elles pas universellement se préoccuper de notre épanouissement individuel et collectif ?
La culture ne nous est pas extérieure, elle n’est pas spirituelle, mais matérielle, elle n’est pas statufiée, mais mouvante. Son destin, sa vie, nous appartiennent, qui que l’on soit.
Car finalement, ce n’est pas d’abord par des solutions scientifiques, encore moins par de vœux pieux et de pensées critiques, que nous pourrons améliorer l’éducation, préserver notre environnement, maintenir et accroître la paix et la joie, et réduire la haine et la violence.
Mais bien, par la pratique solidaire et humaniste de la culture, qui passe autant par les comportements, les paroles et les gestes du quotidien, que les actions, les discours et les manifestations politiques, dans tout ce que ce terme a de noble.
Malgré les doutes, malgré les crises, ou plutôt parce qu’il y a des doutes et des crises, il est temps que la culture soit l’espoir, collectivement de la paix, individuellement de l’épanouissement d’une vie meilleure.
Joie, Bonheur et Liberté : tel devrait être l’étendard de toute culture de la jeunesse.
Sources et références :
Livres :
François Dubet, Trois jeunesses. La révolte, la galère, l’émeute, Lormont, Le Bord de l’eau, series: « CrescendO », 2018, 131 p., ISBN : 978-2-35687-583-9
La guerre des générations aura-t-elle lieu? – Pierre-Henri Tavoillot et Serge Guérin – 2017
Sites Web :
http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/questions/jeuness.html
https://www.tupeuxsavoir.fr/publication/la-jeunesse-nest-quun-mot/
https://www.notretemps.com/famille/autonomie/non-la-guerre-des-generations-n-aura-pas-lieu-19873